LE PRISME
-
.
Définition, description et rôle.
Définition et
description.
Un prisme est un milieu transparent
limité par deux plans non parallèles appelées faces du prisme.
Les
faces d’un prisme font entre elles un angle A appelé angle du prisme, leur
intersection est l’arrête du prisme.

Rôle du prisme.
·
Expériences :
1)
Effet
du prisme sur une source monochromatique (une seule couleur)
Sur
une face principale d’un prisme, envoyons une source de lumière
monochromatique, un écran étant placé en arrière du prisme.
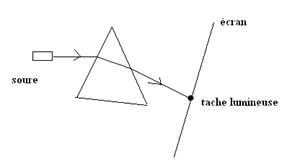
On
constate que la lumière est déviée vers le bas du prisme et forme une tache
lumineuse sur l’écran.
2)
Effet
du prisme sur une source polychromatique.
Envoyons
maintenant sur notre prisme une source de lumière polychromatique (cas de la
lumière blanche), l’écran étant toujours placé derrière le prisme.

On
constate une fois de plus qu’il y’a déviation vers le bas mais aussi, la
lumière est décomposée en plusieurs radiations à déviation croissante du rouge
au le violet.
·
Conclusion.
L’expérience montre donc
que le prisme :
-
Dévie
vers la base tout faisceau lumineux qui le traverse.
-
Décompose
la lumière blanche en plusieurs couleurs (rouge orange jaune, vert, bleue,
indigo, violet).
Marche d’un rayon lumineux et formules d’un prisme.
Considérons
un prisme d’indice de réfraction n,
d’angle A sur lequel on envoie une
lumière monochromatique qui tombe au point I. Ce rayon traverse le prisme et y
sort en I’, après avoir été dévié d’un angle D tel que :
i= angle d’incidence r=angle de réfraction r’=angle d’incidence i’=angle de réfraction D=déviation
totale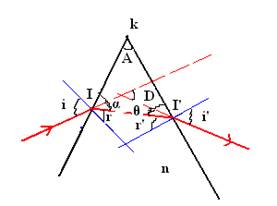
·
Formules du prisme :
En
appliquant la deuxième loi de Descartes en I et en I’, on a :
En
I : sini = nsinr (1).
En I’ : nsinr’ = sini’(2).
Relation
entre A, r et r’ : dans le triangle kII’, A +
α + θ = 180↔ A = 180-α-θ, or r+α =90°,
α=90-r et
r’+θ = 90°, θ = 90-r’, d’où A =180- (90-r) - (90-r’) = r + r’, A =r + r’ (3).
Déviation
totale: Elle est égale à la somme des déviations sur
chaque face du prisme. D = D1+ D2, or
D1 = i-r et D2 = i’-r’, d’où D =( i-r)+( i’-r’) = (i+I’)-(r+r’) = (i+I’)-A car A = r+r’. D = (i+I’)-A (4).
Les
formules du prisme sont donc:
sini = nsinr (1) nsinr’ = sini’ (2) A =r + r’ (3) D = (i+i’)-A (4)
Remarque :
-
Pour
que le rayon émerge du prisme, il faut que r’≤λ
(λ étant l’angle de réfraction limite) tel que sinλ
= n1/n2.
-
Lorsque
les angles sont petits, sini≈i, sinr≈r, les formules du prisme deviennent.
i = nr
(1) nr’ = i’
(2) A =r + r’
(3) D = (i+i’)-A =nr+nr’-A= n(r+r’)-A=nA-A = A(n-1)(4)
Ø Les conditions d’émergence
-condition
à imposer à l’angle du prisme
A
l’entrée du prisme (milieu plus réfringent que l’air), la réfraction a toujours
lieu et l’on a nécessairement r≤ λ .
La condition d’émergence sur l’autre ace est r’≤ λ. En aoutant
membre a membre on a :
A ≤2 λ
Pour
que certains rayons puissent traverser le prisme, il faut que l’angle du prisme
soit inferieur ou au plus égal au double de l’angle limite.
-condition
à imposer à l’angle d’incidence
La
valeur de l’angle d’incidence en dessous de laquelle les rayons ne traversent
pas le prime est i0 telle que :
sini0 = nsin(A- λ)
Ø Influence de
l’angle d’incidence sur la déviation.
L’expérience
montre que la déviation dépend de l’angle du prisme, de l’angle d’incidence et
de l’indice du prisme. Elle varie avec l’un des paramètres lorsque les autres
sont constants.
La déviation
passe par un minimum Dm, au minimum de déviation,
i=i’↔r=r’
alors Dm = 2i-A↔
i = (Dm +A)/2.
A = r+r’ or r=r’↔A = 2r↔r = A/2. On sait que sini
= nsinr↔

Le phénomène d’arc-en-ciel.
Le phénomène d’arc-en-ciel résulte de la
décomposition de la lumière du soleil par des gouttelettes d’eau présentes dans
l’atmosphère. Cette décomposition donne toutes les couleurs du spectre visible
de la lumière blanche.
EXERCICES
EXERCICE I :
Un prisme possède un angle au sommet de 60° et l’indice de son verre est
n = 1,51. Un rayon lumineux sort en J de ce prisme en émergence rasante, c’est
à dire que l’angle de réfraction i2 en ce point est pratiquement
égal à 90°.
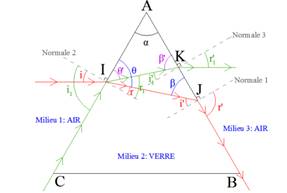
1.
Déterminer l’angle d’incidence i’ en J.
2.
Calculer l’angle de réfraction r en i point d’entrée
du rayon.
3.
Calculer l’angle d’incidence i3 en I.
4.
Calcul de l’angle d’émergence i1 ≈
90°
EXERCICE II :
Soit un prisme d’angle au sommet 60° et
d’indice de réfraction n = 1,5. Donner les valeurs des angles d’incidence,
d’émergence et de l’angle de déviation dans les cas suivants :
-incidence
rasante,
-incidence
normale,
-émergence
rasante,
-émergence
normale.
EXERCICE III :
Un
prisme d’angle A et d’incidence n= 1,5, reçoit une lumière sous une incidence
de 45°.
1° Pour A=60°
1.1° Calculer les valeurs de r et
r’.
1.2° Calculer l’angle limite de
réfraction λ et vérifier la condition d’émergence.
1.3° Calculer l’angle d’émergence
i’.
1.4 Tracer la marche d’un rayon
lumineux
2° Répondre aux
mêmes questions pour A=90°
3° Montrer dans
le cas général, que le rayon ne sortira du prisme que si A≤2λ,
λ étant l’angle limite de réfraction.
EXERCICE IV :
Avec un prisme
de verre (ici le verre flint) d’indice n et d’angle A=60°, on mesure la
déviation minimale (Dm) subie par un rayon de lumière de couleur donnée. Pour
trois couleurs : rouge, jaune et bleu, les résultats sont regroupés dans
le tableau suivant :
|
Couleur
de la lumière |
Rouge |
Jaune |
Bleu |
|
Dm |
47,414° |
48,290° |
53,336° |
|
n |
|
|
|
1.Recopier et
compléter ce tableau en calculant la valeur de n pour chaque couleur, sachant
que :
![]()
2.Que peut-on dire de
l’indice n ? Quel phénomène
observerait-on si l’on envoyait un faisceau de lumière composée des trois
couleurs ci-dessus (Rouge, Jaune et bleu) sur l’une des faces du prisme ?
CORRIGES
EXERCICE I :
1.
angle d’incidence i’ en J (tracé rouge).
n2 . sin i’ = n3 . sin r’ =>
sin i’ = n3/n1 x sin i’ = 1/1,51 . sin 90° = 0,66 D’où: i’ ≈ 41,47
i’ ≈ 41,5° Le rayon d’incidence i’ a donc une
valeur d’environ 41,5°
2.
angle de réfraction r en I
point d’entrée du rayon.
A=r+i’
=>r=A-i’=60-41,5=18,5
3.
Calculer l’angle d’incidence i en I.
n1 . sin i = n2 . sin r =>sini=n2/n xsinr=1,51/1 x sin18,5=0,479 D’où i ≈ 28,67 ≈ 28,7°
Le rayon d’incidence i
a une valeur de 28,7° environ.
4.
Calcul de l’angle d’émergence i2
pour i3 ≈ 90°(tracé
vert).
n1 . sin i1
= n2 . sin r1 =>
sin r1 = n1/n2
sin i1 = 1,00/ 1,51 ≈ 0,662 d’ou r1=41,47
A=r+i’1 =>i’1=60-41,47=18,5
n2 . sin i’1 = n3 . sin r’1 =>sin r’1 ≈ 1,51/1 .
sin 18,5° =>sin r’1 ≈ 0,479 D’où: r’1 ≈ 28,7°
Si
le rayon d’incidence i est en incidence rasante, le rayon qui ressort du prisme
aura une valeur de 28,7°
On peut donc remarquer que si la lumière parcours un trajet dans un sens, elle subira le même trajet
dans l’autre sens
EXERCICE II :
Incidence rasante :
-Angle incidence: i=90°
-Angle d’émergence :
sini=nsinr =>sinr=sini/n=1/1,5=0,667 => r=42° //ici r= λ, angle
limite de réfraction.
nsinr’=sini’ <= >sini’=nsin(A-r)=1,5sin(60-42)= 0,467 => i’=28°
-Deviation:
D = (i+i’)-A= (90+28)-30=58
Incidence
normale : λ=42
-Angle
incidence: i=0 => r=0, r’=A
-Angle emergence:
A=r+r’=r’=60 => r’=60 >λ => il n’y a pas émergence, le rayon
ne sort pas du prisme. On dit qu’l y a réflexion totale
//on ne peut pas trouver i’ tel que sini’
> λ
Émergence rasante :
-Angle d’émergence : i’=90°
nsinr’ = sini’=sin90=1
=>sinr’=1/n=0,667 => r’=42°
-Angle incidence : sini=nsinr=nsin(A-r’)=nsin(60-42)=0,46 =>i=28°
Angle de déviation : D = (i+i’)-A= (28+90)-60=58°
Emergence normale :
-Angle incidence: i’=0
-Angle émergence : i’=0 =>r’=0
A=r’+r=60 => r=60 >42(λ) => il n’y a pas émergence, mais
réflexion totale
//l’angle maximum pour lequel on peut avoir une émergence est
42°
EXERCICE III :
1°
Pour A=60°
1.1° sini=nsinr =>sinr=(sin45)/1,5=0,47 => r=28°
A=r+r’ =>r’=A-r=60-28=32°
1.2°
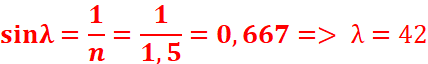
Condition
d’émergence : 2 λ=84 et on a 60≤84 => A≤2 λ
1.3°
angle d’émergence i’. nsinr’ = sini’ =>sini’=1,5sin(32)=0,794 =>i’=52,6°
2° A=90°
2.1° sin=nsinr
=>sinr =sin45/1,5=0,47 => r=28°
A=r+r’ =>r’=A-r=90-28=62
1.2° ![]()
2.3°
2 λ=84 or A=90 est supérieur a 2 λ=84 donc
il y a réflexion totale
3°
r≤ λ
r’≤ λ =>r+r’≤2 λ =>A≤2 λ
EXERCICE IV :
1.
|
Couleur de la lumière |
Rouge |
Jaune |
Bleu |
|
Dm |
47,414° |
48,290° |
53,336° |
|
n |
1,612 |
1,621 |
1,671 |
2.
n varie avec la déviation.
On observerait le phénomène de dispersion de la lumière.